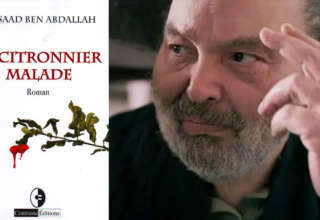Le Temps est au cœur de ces « Récits de l’ombre ». C’est bien de lui qu’il s’agit dans les pérégrinations illuminées vers cette ombre mystérieuse et féroce se profilant autour du poète et de sa création. Un Temps qui « à pas retenus s’avance », « se dépose dans les paroles » et rythme la longue chute verticale des « mots furtifs » empruntés à la nuit et des « images brèves » et évanescentes, gorgées de deuil, mais aussi de quelque lumière. Une lumière fuyante et discontinue, à peine un éclair qui se bat contre l’obscurité dévastatrice, une lueur absolument fragile, enclose dans ce qui reste du rêve et de l’espérance…
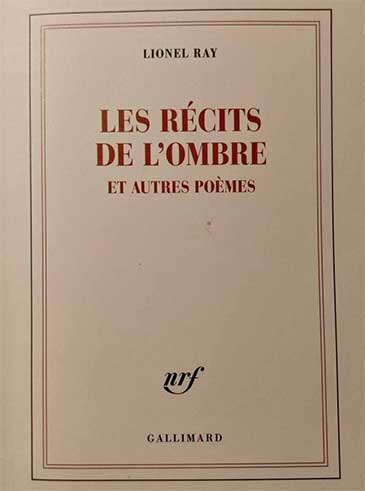
Dans la précieuse « transparence énigmatique » de ces « Récits de l’ombre et autres poèmes » que l’immense poète français moderne Lionel Ray (89 ans) vient de publier aux prestigieuses éditions de « Gallimard », c’est encore Le Temps qui, telle « une encre invisible » s’infiltre secrètement dans les quarante morceaux composant les 4 sections de ce recueil et intitulées de manière très significative « Couleur d’oubli, le Temps », « Les récits de l’ombre », « Poussières du Temps » et « Les récits des traces ».
Tout aussi beau que ceux qui l’ont précédé et chaleureusement habité par l’ « âme » mélancolique et toute savoureuse de ce poète majeur qui a beaucoup marché entre les ombres et les lumières, qui a beaucoup écrit et marqué considérablement la postmodernité poétique française, ce nouveau recueil nous apprend par ses vers vibrant d’émotion, après la poésie de Ronsard, de Lamartine ou de Baudelaire, après ce qu’en ont dit les poètes, tous morts, auxquels Lionel Ray dédie à l’ouverture de ses « Récits de l’ombre », Eugène Guillevic (1907-1997), Georges-Emmanuel Clancier (1914-2018) et Luis Mizon (1942-2022), qu’il n’ y a rien d’autre au fond dans toute vraie poésie, qu’elle parle de l’amour ou de la mort, que le Temps que nous traversons ou qui nous traverse avec ou sans douleur, « le Temps étroit/ qui nous enserre/ et qui nous broie » (p. 68), qui nous traîne, en nous vieillissant, jour après jour, année après année, sur cet incontournable « chemin dont nul n’est revenu » : « Le temps, c’est le thème majeur de toute poésie. De tout poème. », remarque donc l’auteur de « Souvenirs de la maison du Temps » (Gallimard, Nrf, 2017) qui ajoute : «Le temps qui passe, ou qui ne passe pas. Il obsède et tyrannise. On voudrait l’arrêter, il fuit.
Il est insaisissable. Tel est le tourment du souvenir et du regret. Nous sommes en débat avec le temps, les saisons, l’âge, tout cela que nous cherchons à saisir et qui nous échappe. Mais sait-on ce que c’est que le temps ? Depuis la philosophie de Saint Augustin, la question se pose et elle reste sans réponse. La physique moderne avec les astrophysiciens cherche à ce sujet des réponses qu’elle ne trouve pas. Pourtant nous savons bien qu’il existe, le temps, comme l’attestent les calendriers, les horloges, les horaires de chemins de fer, mais nous ne savons pas ce qu’il est ni d’où il vient. C’est évidemment paradoxal et tourmentant.
On peut tout juste constater ceci : c’est que l’écriture est une façon (parmi d’autres) de mesurer le temps qui passe. « D’un mot à l’autre je suis plus vieux », écrit l’un de nos plus grands poètes, Philippe Jaccottet. Et Baudelaire de dénoncer violemment ce « tyran sans merci » qui l’accable. J’ai eu pour ma part l’occasion de dire, souvent, que tout poème (…) est poème du temps. Ce constat est au coeur de ma poésie… » (Cf- Notre entretien avec ce poète, ce journal du 5 mars 2022)). Oui, le Temps est au cœur de ces « Récits de l’ombre ». C’est bien de lui qu’il s’agit dans les pérégrinations illuminées vers cette ombre mystérieuse et féroce se profilant autour du poète et de sa création.
Un Temps qui « à pas retenus s’avance », « se dépose dans les paroles » et rythme la longue chute verticale des « mots furtifs » empruntés à la nuit et des « images brèves » et évanescentes, gorgées de deuil, mais aussi de quelque lumière. Une lumière fuyante et discontinue, à peine un éclair qui se bat contre l’obscurité dévastatrice, une lueur absolument fragile, enclose dans ce qui reste du rêve et de l’espérance, en dépit de l’âge, de la solitude qui « ruisselle sur la pierre des murs » (p. 68) et de la maladie. C’est à elle que Lionel Ray arrime ses vaisseaux de roses, éprouvées par les vagues, après « la traversée des saisons » (p. 67), et interroge encore le Temps qui menace de plus en plus de suspendre sa marche au-dessus de ses poussières et chimères : « Mémoire envahie d’ombres/ et de feuilles froissées/ blessures du temps/ cet alphabet de l’impossible/ corps inconnu et qui s’étonne ! » (…) Vers quoi s’orientaient les jours ?/ Ce roman qu’on lit à l’envers/ ô voyageur ! Il n’ y a plus de gares/ les noms s’effacent et les silhouettes/ s’éloignent dans la nuit (…)/ Il ne reste plus qu’à poser/ nos bagages de vent sur cette pierre/ sans regard et sans nom dédié/ à la profonde la maternelle/ Nuit » (pp. 27-29).
Habité par « l’ombre » qui est ici « souveraine » (p. 28) et qui serait fort probablement la métaphore filée de la mort qui semble marteler l’esprit du poète, Lionel Ray semble écouter, en même temps que ces mots désespérés, chuchotés par son autre lui-même, ce « Je » qui le cherche dans le « théâtre » de la vie et de son « décor incertain et qui s’efface » (p. 24), la voix lointaine et sereine de Charles Baudelaire (1821-1867) déclamant, de derrière son miroir au tain abîmé, ces vers lucides clôturant « Le voyage » : « Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! Levons l’ancre !/ Ce pays nous ennuie, ô Mort ! Appareillons! » (Les Fleurs du mal, section « La mort »)
Comme de l’encre, le ciel et la mer sont noirs (Ibid.), « l’ombre est épaisse » (p. 51), «sans vertige/ Sur la plus haute branche/ L’oiseau du Temps regarde » (p. 50) « La vie (qui) insiste et rêve » (Ibid.), « ces trouées de lumière entre les arbres obscurs » (Ibid.) avant de s’envoler avec les secrètes rêveries d’éternité de l’homme-poète voué à la disparition, qui « n’est personne » qui « n’est rien », « à peine un souffle, un nuage / un mot désappris silencieux » (Ibid.). La mort nouée à la vie (p.66) est là, même si jusqu’ici la poésie n’a fait que la contourner, la repousser, la tromper, la transcender pour qu’elle devienne lumière intérieure. Non, il n’ y a plus rien à faire que de continuer à écrire « tout ce que nous avons aimé/ la fraîcheur d’une clairière/ les ronciers, les caves/ nos songes dormants/ (…) les mots/, les rires, les hivers, les regards… » (69).
Des interstices de la mémoire qui est « une cave où l’on ne marche qu’au ralenti » (p. 28) affluent donc et s’emboîtent les unes dans les autres les réminiscences, les douleurs, les cicatrices indélébiles, les épaves du Temps et les joies de toute une trajectoire vitale marquée par un destin souvent éprouvant et que le poète raconte de manière discontinue et morcelée, en brouillant les pistes, en mettant à contribution une permanente dialectique de l’apparent et du caché et en passant tour à tour du souvenir vraisemblable à l’invention créatrice (« Je ne me souviens pas, j’invente » (p. 40)) et en gardant toujours ce difficile équilibre du « mentir-vrai ». Le visage pris entre cette « ombre » fantomale et la lumière de l’inspiration et de la magie verbale, Lionel Ray dont le cheminement poétique est fait d’un incessant va-et-vient entre le réel et le songe, entre le vécu au quotidien et « la dictée intérieure » qui décide de la nature du poème, de son tracé et de son souffle, organise une poésie de diamant qui est dans ce recueil, comme souvent dans ses autres livres, un ruissellement vertigineux de mots au sens furtif flottant comme un fil de brouillard au-dessus des vers et qui ne s’appesantissent jamais sur leurs référents ; un ruissellement d’images aériennes, de syntaxe fracturée par endroits, d’ unités segmentaires à volumétrie variable, paires et impaires, de vers raccourcis, troués ou brisés par des rejets et enfin de silence, beaucoup de silence semblable à celui qu’on observe entre deux prières, qui est recueillement, parole intérieure, jouissance spirituelle triomphant des « fracas de la tonitruance » et qui ponctue la parole et enveloppe avec tendresse, cette saisissante poétique de la douleur qui ne dit pas toujours son nom et que le poète, en sage ou en ascète, s’emploie à sublimer, à illuminer, en ouvrant aux lecteurs la fabuleuse voie du rêve.
Voici donc un Lionel Ray bien fatigué, empli, par le Temps, mais constamment infatigable à écrire la beauté de l’éphémère, à composer, avec force et pénétration, son intarissable poésie encline à cette irréductible « discrétion pénétrante », à cette écriture en demi-teinte rendant « énigmatique » la transparence des mots et tirant un léger voile de brume sur les pertes et les plaies que dit ou chuchote le poème vécu comme une espèce d’ascèse, une relecture de soi-même et du monde, une renaissance, et qui sont compensées par « le gain du chant » ou par cette atteinte magique d’un au-delà de la vie, d’un au-delà du temps, en narguant sereinement « L’ombre » qui rôde, qui s’approche et qui menace.
Lisons, pour finir, cette strophe clausulaire fermant ces troublants « Récits de l’ombre » :
« Mais qui donc êtes-vous qui venez à ma rencontre/ Sœur solitude ! trange lumière, terre d’abîme./ J’entre dans la géographie du silence et me voici/ face à face parmi les débris du feu avec cette clé/ improbable ! Je cherche encore et toujours une réponse/ à tant d’effroi. Qui donc êtes-vous, labyrinthe ? D’où partir ? où revenir ?/ Me voici/ le messager de l’espace du dedans,/ le printemps exact,/ soleil vertical !/ soleil debout » (pp. 69-70).